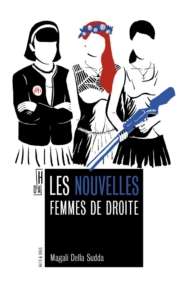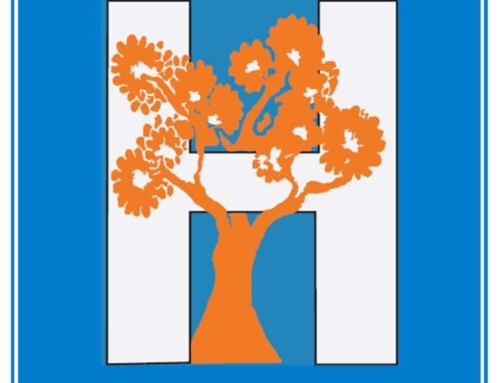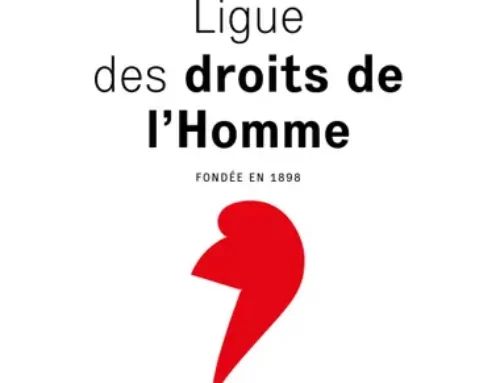Vous trouverez ci-dessous une courte Vidéo de Magali Della Soudda qui directrice de recherches à Sciences Po Bordeaux) sur les nouvelles femmes de droite , voici une vidéo réalisée sur le sujet, à partir des analyses de son livre et un article du Monde où elle est citée.
L’extrême droite se présente en vigie féministe, sans renier ses idées xénophobes (article du Monde)
Du collectif Némésis à Marine Le Pen, la droite nationaliste s’est convertie, en façade, à la cause des droits des femmes. Un « fémonationalisme » qui lui a permis d’élargir son électorat.
Féministe, l’extrême droite ? Depuis une dizaine d’années, les mouvements nationalistes et identitaires français se posent comme les vigies des droits des femmes, notamment face aux violences sexuelles. Ce phénomène a encore été récemment illustré par le procès de la meurtrière de Lola et la tentative de viol dans le RER C, largement relayés et instrumentalisés dans leurs sphères militantes et médiatiques. Ce virage, qui s’observe dans le discours du Rassemblement national (RN) comme dans celui de plusieurs de ses homologues européens, marque une rupture spectaculaire avec une tradition de positions patriarcales.
Une vision longtemps réductrice de la femme
L’extrême droite a longtemps envisagé les femmes sous un angle procréatif, celui du ventre de la civilisation blanche, loin des revendications émancipatrices féministes. En 1996, Jean-Marie Le Pen déclarait ainsi au Parisien qu’il est « ridicule de penser que leur corps leur appartient, il appartient au moins autant à la nature et à la nation ».
Le Front national (FN, ancêtre du RN) est ainsi resté jusqu’à la fin des années 2000 un parti d’hommes. « Les positions de Jean-Marie Le Pen sur l’avortement, sa mise en avant de la virilité et son phrasé sexiste et misogyne ont longtemps freiné les femmes de rejoindre le parti », relève le sociologue Sylvain Crépon. Jusqu’à l’émergence, dans les années 2010, d’une génération de militantes d’extrême droite moins enclines à rejeter l’héritage féministe.
En 2012-2013, les débats sur l’extension du mariage aux couples de même sexe suscitent un vaste mouvement de réaction, la Manif pour tous, qui s’oppose à l’abolition des normes sexuelles naturelles et traditionnelles que promeut, à ses yeux, le progressisme.
Loi Taubira et émergence d’un féminisme de droite
Dans les mois suivants apparaît une galaxie de collectifs féminins hostiles à la loi Taubira. Si certains nourrissent une vision catholique et conservatrice de la femme (comme les Caryatides), d’autres la voient blanche, émancipée et combative (le webzine militant Belle et rebelle) ou mystique et naturelle (le mouvement Antigone). Toutes revendiquent un féminisme « de droite », « occidental » ou encore « identitaire », qu’elles opposent à un féminisme « radical ».
Dans leur sillage, l’électorat du FN se féminise, bouleversant son socle de valeurs. Ces nouvelles militantes ont grandi dans un monde où la norme entre hommes et femmes est égalitaire. « Pour rien au monde, elles ne renonceront aux droits que la société leur garantit ou leur promet, observe Magali Della Sudda, autrice des Nouvelles femmes de droite (Hors d’atteinte, 2022). Elles ont, en quelque sorte, “patrimonialisé” cet héritage du féminisme. »
Arrivée à la tête du FN en 2011, Marine Le Pen adapte son discours à cette nouvelle donne, en cessant, par exemple, de dénoncer l’« avortement de confort » à partir de 2012.
Un « fémonationalisme » hérité des clivages féministes
L’ADN xénophobe du parti, lui, ne disparaît pas, mais sa grammaire change : désormais, il ne s’agit plus tant de défendre la nation française contre les étrangers que de défendre une civilisation qui aurait le monopole de l’émancipation féminine, incarnée par des figures comme Brigitte Bardot ou Catherine Deneuve, contre des visions patriarcales importées.
« Que des femmes d’extrême droite se définissent aujourd’hui comme féministes a été rendu possible car le féminisme de gauche a eu des discours racistes », juge Valérie Rey-Robert, l’autrice de Dix questions sur la culture du viol (Libertalia, 2025), qui cite en exemple les débats autour de l’interdiction du voile islamique, durant lequel des féministes universalistes comme Elisabeth Badinter ont associé le foulard musulman à une norme patriarcale oppressive et pathologique – position depuis reprise par le RN.
Récit xénophobe sur le viol
Les discours fémonationalistes se multiplient avec la crise migratoire. La Saint-Sylvestre 2015 à Cologne, en Allemagne, marquée par une vague d’agressions physiques et sexuelles attribuées à des immigrés, marque le début de leur systématisation. « J’ai peur que la crise migratoire ne signe le début de la fin des droits des femmes », déclare alors Marine Le Pen.
La dirigeante frontiste, note Sara R. Farris, a « suivi la stratégie d’autres partis nationalistes d’extrême droite, pour qui la mobilisation de l’égalité entre les sexes s’avère cruciale pour diaboliser les hommes migrants non occidentaux, en particulier les musulmans ». Depuis, ils sont régulièrement présentés comme les ambassadeurs d’une culture patriarcale misogyne, voire, dans les franges les plus identitaires, comme d’un « djihad du viol ».
Dans la foulée, plusieurs collectifs xénophobes de défense des femmes contre les agresseurs immigrés se créent, comme Women’s Satefy Initiative, au Royaume-Uni en 2017, ou Némésis, en France en 2019. « L’instrumentalisation raciste d’idées féministes dans le cadre d’une campagne anti-immigration est devenue un pilier » de l’extrême droite occidentale, observe Sara R. Farris.
Vision caricaturale de l’agresseur sexuel
Ce militantisme fémonationaliste repose pourtant sur un mythe de l’étranger violeur construit à renforts de chiffres biaisés. Alors que le très exhaustif service statistique du ministère de l’intérieur évalue à 13 % la part de violences sexuelles commises par des étrangers en 2022, Jordan Bardella et Marion Maréchal martèlent qu’elle est de 77 % lors de la campagne pour les européennes de 2024. Un chiffre qui ne porte que sur un échantillon restreint de 36 personnes interpellées à Paris pour des viols sur la voie publique.
« Ces mouvements racistes, transphobes, sexistes sélectionnent les victimes pour servir un agenda sécuritaire et anti-immigration », juge Valérie Rey-Robert. Pas question de reconnaître que les auteurs de violences sexuelles sont aussi Blancs ou Français, ni que dans neuf cas sur dix l’agresseur est connu de la victime. D’ailleurs, lorsque le RN propose de légiférer sur le viol, c’est le plus souvent dans le cadre de propositions contre « l’idéologie islamiste » et les étrangers en situation irrégulière.
De même, le RN s’émeut peu des scandales sexuels dans l’Eglise, des accusations de viols contre Gérard Depardieu ou encore de l’affaire des viols de Mazan, nourrissant l’impression d’un double standard. « Le projet politique d’extrême droite repose sur le postulat que les êtres humains et les civilisations ne sont pas égaux », pointe Magali Della Sudda, une idée « incompatible » à ses yeux avec le féminisme historique, égalitaire et universel.
Un succès électoral, mais après ?
D’un point de vue électoral, ce discours de défense des femmes semble néanmoins faire mouche. En 2024, elles sont désormais 30 % à voter pour le RN, presque autant que les 32 % d’hommes. « Marine Le Pen l’a vraiment utilisé de manière très subtile et adroite, et le fait qu’elle soit une femme n’a pas été anodin », relève Sylvain Crépon.
Dans les faits, son projet pour la cause féminine reste pourtant flou. « A part dire qu’on garde ce qui se fait déjà, qu’y a-t-il dans le programme pour améliorer la santé des femmes ou leur sécurité ? Rien », s’interroge le sociologue. Le parti frontiste s’est même opposé à une résolution européenne de 2021 sensibilisant au harcèlement sur les lieux de travail. Lors des débats, l’eurodéputée RN Annika Bruna avait argué que « la lutte contre le harcèlement sexuel ne doit virer ni à l’obsession ni à la suspicion généralisée ».
L’examen du budget 2026 apporte une nouvelle preuve de l’intérêt que porte le RN à la cause féminine : afin de faire des économies, le parti suggère de réduire de 16 millions d’euros – soit un quart du total – les subventions accordées par l’Etat aux associations œuvrant à la promotion des droits des femmes.
 AVEYRON
AVEYRON