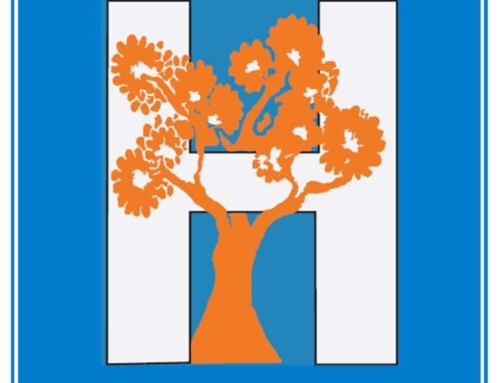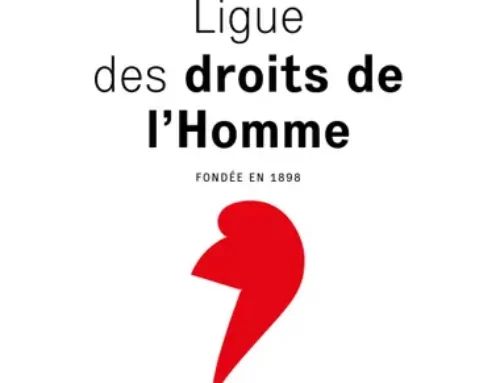Lors des congrès de Metz (2022) puis de Rennes (2025), la FSU a avancé dans ses mandatements relatifs à l’école privée. Désormais, elle revendique la fin au financement public de l’enseignement privé sous contrat dans la perspective de sa nationalisation (Metz). Elle s’est dotée d’un mandat d’étude concernant les conditions de la mise en œuvre de cette nationalisation, afin d’aboutir à un grand service public laïque unifié (Rennes).
La première journée a d’abord été l’occasion d’un rappel historique des batailles contre le dualisme scolaire. Tous les gouvernements se sont accommodés du dualisme après la défaite de 1984 sur la mise en place d’un « grand Service public unifié et laïque de l’Éducation nationale ». Depuis plusieurs décennies, des mesures ont profité à l’enseignement privé : paiement des salaires des enseignant·es, poursuite de l’assouplissement de la carte scolaire et des systèmes dérogatoires, aides aux écoles de production et aux lycées professionnels privés… Deux SD (la Loire Atlantique et Paris) ont été invitées à témoigner de la situation locale. Si tout n’est pas identique, on s’aperçoit que des logiques d’évitement du public populaire sont les mêmes dans certains quartiers nantais et arrondissements parisiens, que les IPS sont dramatiquement bas dans les établissements publics des zones d’éducation prioritaire et que le rôle des politiques est un véritable enjeu pour diminuer le financement du privé et mettre fin au dualisme scolaire.
Nationaliser, oui, mais comment ?
Différentes façons de nationaliser l’enseignement privé ont été présentées par G. Calvès (professeure de droit public à l’Université de Cergy Pontoise) :
- l’intégration prévue dans la loi Debré est le fait d’absorber un établissement privé qui en fait la demande, dans le service public. Tous·tes les salarié·es actuellement sous contrat d’agent·e publi·que basculent fonctionnaires. L’intégration doit respecter les valeurs constitutionnelles donc plus de possibilité d’y faire le catéchisme.
- la nationalisation au sens propre : l’appropriation des moyens de production. Mais pour être constitutionnelle, elle doit être juste et proportionnée, donc des indemnités doivent être négociées au préalable (le coût serait à première vue exorbitant car le privé possède des biens immobiliers de grande valeur, mais ceux-ci viendraient ensuite grossir le patrimoine public) et surtout, il faut démontrer une « impérieuse nécessité ». En revanche, la nationalisation permet le transfert des moyens et des personnels.
- le retour au monopole, mais la constitution prévoyant la « liberté d’enseigner », le risque de l’échec existe, sauf à entériner le maintien d’un enseignement privé hors contrat.
Ces différentes possibilités montrent le chemin à parcourir : la nationalisation de l’enseignement privé nécessitera une modification constitutionnelle pour faire sauter l’obligation de verser « une juste et préalable indemnité », et la « nécessité publique » inscrites à l’heure actuelle dans le droit. Le Collectif pour la défense de l’école publique et laïque, initié par la FSU, doit se saisir de ces questions car les interventions des syndicats nationaux ont mis en exergue une dynamique commune : le privé se gave d’argent public, le Service public d’éducation subit des attaques continues qui aboutissent à son lent démantèlement et à une ségrégation sociale croissante. Dans l’immédiat, pour réduire l’influence néfaste du privé, des lois existent : le contrôle des établissements pouvant déboucher sur le retrait de l’agrément du chef d’établissement ordonné par le rectorat, la résiliation du contrat d’associations… Le seul arrêt du financement de l’enseignement privé sous contrat en ferait fuir les classes moyennes, sans empêcher l’entre-soi de la bourgeoisie, qui a les moyens de se financer une école privée.
Des inégalités socio-scolaires vitales pour le privé, entretenues par les politiques publiques
Fédérini (docteure en sociologie spécialiste des politiques éducatives ) a montré comment la fragmentation du système scolaire en trois secteurs (enseignement privé, enseignement public et en son sein, éducation prioritaire) entretient et creuse les inégalités sociales et scolaires, vitales pour le privé. Les politiques éducatives jouent son jeu en le favorisant, amenant à une compétition entre établissements y compris publics et transformant l’école en un marché scolaire sous prétexte de « liberté de choix » des familles qui est surtout, en réalité, la liberté de choix de leurs élèves par les établissements privés. Leur prétendu « caractère propre » religieux est quasiment effacé lorsqu’il s’agit d’établissements privés peu élitistes. Dans le cas des établissements privés élitistes, cette dimension religieuse est imposée à un public captif comme une forme de garantie supplémentaire de rigueur et d’exigence. Ce sont les élèves issu·es des milieux populaires qui sont les grand·es perdant·es de cette opération : l’égalité des chances qui préside aux politiques publiques est en fait une sorte d’« aide-toi et le ciel t’aidera » républicain de bon aloi ; un masque derrière lequel ces politiques peuvent perpétuer les inégalités jusqu’à un tel affaiblissement de l’État, que l’enseignement privé est autorisé à contester la loi, comme en témoigne sa lecture propre des programmes, et à promouvoir, de concert avec les ministres de l’Éducation depuis Blanquer, des valeurs, au détriment des principes de la République. Une priorité est de s’en prendre au privé élitiste. Soumettre l’enseignement privé à la carte scolaire est une piste pour y parvenir.
L Lecuyer (doctorante au sein du Centre de Recherches sur les inégalités sociales de Sciences Po) a montré que l’existence d’une offre scolaire privée autorise certains parents issus des classes moyennes supérieures à s’installer dans ces espaces populaires et donc contribue à leur évolution socio-résidentielle. Pour autant, elle observe aussi que cette offre scolaire privée permet à des familles populaires déjà présentes sur place d’y scolariser leurs enfants, dans le but de les séparer de celles et ceux issu·es de milieux encore plus précarisés. Si la ségrégation résidentielle est en partie responsable de la ségrégation scolaire dans le public, c’est principalement l’existence d’une offre privée qui empêche une plus grande mixité du public accueilli dans le collège public d’un quartier qui se gentrifie. L. Lecuyer a enfin montré que la sélectivité résidentielle croissante va de pair avec le développement d’une offre privée de plus en plus sélective. Ce sont dans les espaces les plus socialement favorisés que le recours au privé est le plus massif, car c’est aussi là que l’offre privée est la plus importante. La bourgeoisie reste la grande gagnante de cette ségrégation socio-scolaire.
« Nationaliser » les personnels de l’enseignement privé sous contrat
Dans les établissements privés sous contrat travaillent plusieurs catégories de personnels :
– les enseignant·es qui, sans être dans une position réglementaire et statutaire de fonctionnaires, sont des contractuel·les de droit public recruté·es par concours, et formé·es dans les INSPE, avec des carrières comparables à celles des enseignant·es du public.
– les personnels administratifs quant à eux ne sont pas des agent·es publics.
La FSU militant pour que les emplois publics soient occupés par des fonctionnaires, il faut revendiquer des dispositions visant leur titularisation, pour que la gestion des ex-personnels des établissements privés n’entre pas en concurrence avec celle des titulaires, au détriment de ces dernier·ières. Cependant, un plan de titularisation de ce type entraînerait des effets de bord à ne pas négliger : des cohortes de personnels seraient massivement intégrées dans les corps existants, avec un impact sur la carte des emplois publics sur le territoire, qui pose des questions de mobilité, et sur les promotions quand ces personnels viendront s’intercaler. Faut-il « aspirer » tout le monde, ou distinguer les deux populations jusqu’à un certain stade ? Il y a aussi la question des pensions, avec pour les personnels venant du privé un calcul basé sur deux régimes pouvant entraîner une dégradation de leurs droits. Il faudrait par exemple réfléchir à des mesures correctives.
Une réflexion sur tous ces sujets doit avoir lieu dans les syndicats nationaux concernés, pour irriguer les mandats fédéraux et proposer un projet fédérateur et mobilisateur pour les personnels du public comme du privé.
 AVEYRON
AVEYRON